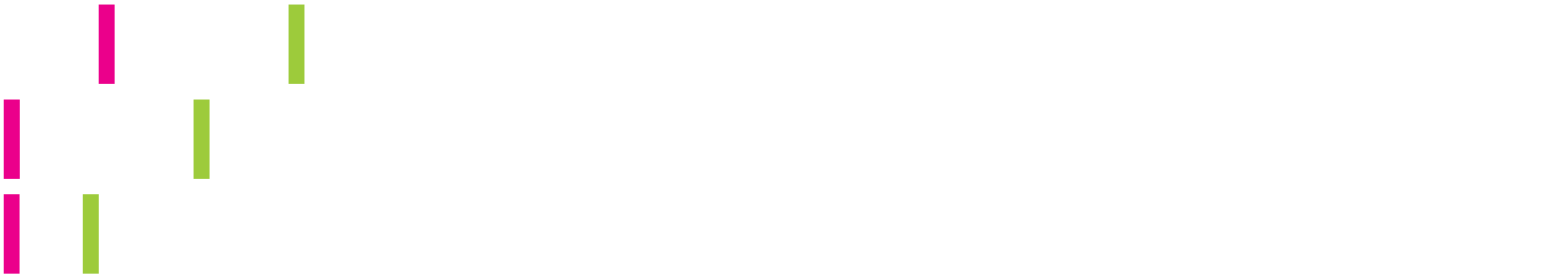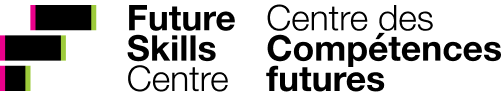État des compétences
Pour une main-d’œuvre canadienne résiliente : Les compétences à acquérir dès maintenant et pour l’avenir

Perspectives clés
Les compétences générales sont essentielles pour occuper les emplois d’aujourd’hui et de demain. Ce sont d’ailleurs les plus recherchées, tous secteurs confondus, et ce, quelle que soit la taille des organisations, des PME aux grandes entreprises. Même lorsqu’un poste exige des compétences numériques, la formation est plus efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un perfectionnement des compétences générales.
Bon nombre d’emplois au sein des économies actuelles et futures requièrent la maîtrise de plusieurs types de compétences (techniques, générales, numériques, etc.), d’où l’impérieuse nécessité pour les travailleurs d’acquérir un profil diversifié.
Les emplois de demain ne feront plus appel aux mêmes compétences. Les pertes engendrées par les mutations économiques dans certains secteurs seront compensées par la croissance générale de l’emploi, sous-tendue par différents profils de compétences.
 L’enjeu
L’enjeu
En juin 2025, on comptait 492 000 postes vacants au Canada, et ce, malgré le taux de vacance le plus bas depuis 2017. Une grande partie de ces postes inoccupés est en raison d’un décalage entre les compétences, c’est-à-dire lorsque les compétences demandées ne correspondent pas à celles disponibles sur le marché du travail. Les employeurs de tous les secteurs au Canada continuent de signaler des difficultés à trouver la main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin. Le Conference Board du Canada a constaté un écart considérable entre les compétences nécessaires pour l’économie de demain et celles possédées par la main-d’œuvre canadienne actuelle, ce qui a coûté 2,6 milliards de dollars à l’économie en 2024 et réduit la productivité de 0,1 point de pourcentage. Plus précisément, le Canada manque d’au moins 64 000 travailleurs qualifiés dans les domaines de l’ingénierie, des professions techniques, des biens à haute qualification et d’autres services à haute qualification, chaque poste vacant supplémentaire coûtant à l’économie canadienne environ 40 400 dollars.
Même si les données probantes issues du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) de l’OCDE indiquent qu’en moyenne, les Canadiennes et les Canadiens obtiennent de bons résultats en numératie, en littératie et en résolution adaptative de problèmes comparativement à d’autres pays, on recense encore trop de personnes ayant un niveau de compétence inférieur dans ces domaines cruciaux, ce qui les rend vulnérables aux perturbations désormais courantes (sous l’effet de l’automatisation, entre autres) et engendre des pénuries de main-d’œuvre.
La demande des employeurs pour les compétences générales a également augmenté afin de compléter les compétences techniques.Ils sont difficiles à automatiser, mais leur enseignement s’avère également chronophage et coûteux dans la mesure où elles s’acquièrent généralement sur plusieurs années d’études et de formation. Si bon nombre d’employeurs déclarent que les compétences générales sont essentielles, il n’existe aucun consensus quant à la manière dont il convient d’évaluer et de certifier leur maîtrise. Les apprenants et les travailleurs n’ont donc pas la certitude que les employeurs en tiendront compte. Il s’avère également difficile pour les employeurs de prendre des décisions d’embauche sur la base de compétences qu’ils ne savent pas comment définir, mesurer ou évaluer.
Cette problématique est particulièrement sensible pour les petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles représentaient environ 99,6 p. 100 des entreprises canadiennes en 2024. En effet, dans bien des cas, les PME ne disposent pas de ressources humaines suffisantes pour investir dans l’évaluation des compétences et le perfectionnement professionnel de leur main-d’œuvre actuelle, ce qui nuit à l’efficacité du recrutement et au maintien en poste. D’après une enquête menée récemment auprès des PME canadiennes, environ la moitié des organisations interrogées ont déclaré avoir des difficultés à trouver des candidats dont les niveaux de compétence correspondaient aux postes à pourvoir. Lorsque les PME parviennent à embaucher, elles rencontrent souvent des problèmes pour dispenser de la formation additionnelle à leur personnel. En 2022, 70 p. 100 des employés au sein des PME canadiennes ont exprimé un intérêt vis-à-vis des possibilités de formation externe. Pourtant, ils n’avaient été que 12 p. 100 à suivre une quelconque formation au cours de l’année précédente. Dans les structures de taille modeste, la capacité à financer des formations est souvent restreinte par manque de liquidités ou en raison d’un accès limité au capital. Ces petites entreprises ont également besoin que leur personnel soit en poste : le coût d’opportunité à assumer lorsqu’elles envoient des travailleurs en formation est élevé.
Alors que l’immigration constitue historiquement le principal moteur de croissance de la main-d’œuvre au Canada, beaucoup de nouveaux arrivants peinent à faire reconnaître leurs compétences, ce qui complique leur transition vers un emploi à la hauteur de leurs aptitudes. D’après une étude récente, par exemple, plus de 25 p. 100 des immigrants fraîchement arrivés au Canada et titulaires d’un grade universitaire de niveau baccalauréat occupent des emplois nécessitant seulement un diplôme d’études secondaires, voire un niveau d’instruction inférieur, soit un taux trois fois plus élevé que celui observé parmi les travailleurs nés au Canada. La reconnaissance des titres de compétences est un processus souvent long et compliqué qui compromet la capacité du Canada à pourvoir des postes capitaux.
Les établissements d’enseignement postsecondaire jouent un rôle crucial à l’appui du perfectionnement des compétences, dans la mesure où environ 80 p. 100 des postes vacants exigent une forme d’éducation postsecondaire. Ce niveau d’instruction s’accompagne d’une hausse de salaire au fil du temps et de l’acquisition d’un vaste éventail de compétences, notamment générales et numériques. Les derniers résultats du PEICA mettent également en évidence une corrélation entre l’achèvement d’études postsecondaires et la maîtrise des compétences. Or, les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada sont actuellement aux prises avec d’importants déficits budgétaires par suite des modifications du plafond des effectifs étrangers et du manque à gagner associé aux droits de scolarité connexes. Bon nombre de collèges et d’universités au Canada sont donc en train de réduire leurs programmes et de licencier du personnel.
Outre les déficits de compétences au sein de la population active, les pénuries de main-d’œuvre sont particulièrement graves dans divers secteurs clés comme les soins de santé et la construction. La population canadienne étant vieillissante, la demande de services de santé va croissant. D’après le Conference Board du Canada, plus de 80 000 postes d’infirmiers, d’éducateurs de la petite enfance et de travailleurs de soutien en milieu social et communautaire sont à pourvoir actuellement (ce chiffre inclut les infirmiers autorisés, les infirmiers psychiatriques autorisés, les aides-infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les associés au service de soins aux patients et les infirmiers auxiliaires autorisés). On s’attend par ailleurs à ce que les taux de vacance dans ces professions atteignent au moins 30 p. 100 d’ici à 2040. À l’heure actuelle, le secteur de la santé représente environ 12,4 p. 100 du PIB annuel du Canada, soit plus de 370 milliards de dollars. Ces postes vacants se traduisent par une perte de productivité globale et une diminution des soins prodigués à la population, pourtant de plus en plus dépendante d’une prise en charge professionnelle.
Le secteur de la construction représentait environ 7,4 p. 100 du PIB canadien en 2024. Or, compte tenu du vieillissement de la main-d’œuvre, il devrait être amputé de 21 p. 100 de ses effectifs au cours de la prochaine décennie. Cette perte majeure de personnel et d’expérience n’est pas une bonne nouvelle dans le contexte des pénuries de logements qui préoccupent les collectivités et les législateurs partout au Canada. Le gouvernement fédéral a pour objectif de construire des logements rapidement, et ce, en employant des technologies et des matériaux à plus faible intensité carbonique, mais il n’est pas certain que le pays dispose de la main-d’œuvre et des compétences nécessaires pour y parvenir. BuildForce estime que le secteur canadien de la construction devra recruter quelque 250 000 nouveaux travailleurs de moins de 30 ans au cours des dix années à venir. Plusieurs initiatives visant à améliorer les stratégies de recrutement ont été mises en œuvre afin d’attirer un vivier de talents plus diversifié vers les métiers spécialisés. À cette difficulté s’ajoutent les déficits de compétences déjà observés au sein de la main-d’œuvre actuelle : en effet, cette dernière doit suivre de la formation additionnelle sur les techniques de construction à plus faible intensité carbonique.
Définitions :
- Compétences générales : ce sont les compétences qui permettent à l’être humain de coopérer dans le cadre d’un travail d’équipe, de réguler ses pensées et ses émotions, de réfléchir stratégiquement et de saisir les ambiguïtés. Autant d’attributs qui sont mis à profit de manière tangible en milieu professionnel et qui sont donc très prisés par les employeurs. Il existe d’autres termes pour désigner les compétences générales. On peut notamment parler de compétences socio-émotionnelles, humaines, essentielles ou encore fondamentales. À titre d’exemple, citons : l’empathie, la collaboration, l’intelligence émotionnelle, la communication, la résolution de problèmes, les attitudes et comportements positifs, ainsi que l’adaptabilité.
- Compétences techniques : il s’agit de connaissances spécialisées et d’aptitudes appliquées servant à exécuter des tâches pointues, telles que celles requises dans les métiers de l’électricité, de la plomberie, des technologies médicales, du génie civil, mécanique ou industriel, de l’inspection ou de la réglementation.
- Compétences numériques : les compétences numériques sont, par nature, des compétences techniques dans le domaine informatique. On distingue plusieurs niveaux de maîtrise des compétences numériques, allant de l’utilisation de logiciels tels que Microsoft Office (compétence élémentaire) au développement de plateformes en ligne (compétence de pointe).
- Compétences vertes : il s’agit des compétences (des plus élémentaires aux plus avancées) en lien avec la promotion et la mise en œuvre de pratiques durables sur le plan environnemental qui sont nécessaires à la transition vers une économie à plus faible intensité carbonique, telles que la compréhension du changement climatique, des politiques et lignes directrices environnementales en vigueur, de la durabilité des chaînes de valeur et du calcul de l’empreinte carbone.
 Ce que nous examinons
Ce que nous examinons
Depuis sa création en 2019, le Centre des Compétences futures (CCF) a investi dans des projets axés sur la recherche et l’innovation pour faire en sorte que la main-d’œuvre canadienne possède les compétences requises, au bon endroit et au bon moment.
Comment perfectionner les compétences générales des travailleurs?
Les compétences générales ont toujours été importantes, mais elles sont rapidement en train de devenir essentielles pour l’avenir du travail au Canada à mesure que l’automatisation transforme les tâches manuelles et techniques, car beaucoup d’emplois exigent de plus en plus un travail collaboratif. L’acquisition de compétences générales aide les travailleurs à démontrer aux employeurs leur aptitude en la matière. Si les compétences techniques demeurent importantes, nombre d’entre elles sont concernées par l’automatisation, et les employeurs ont besoin de personnel pour pourvoir les postes qui requièrent la maîtrise de plusieurs compétences générales que l’IA n’est pas en mesure de reproduire. Prenant acte de l’importance des compétences générales, le CCF a mené des projets afin d’appréhender la meilleure manière de former les travailleurs dans ce domaine, d’une part, et de mieux comprendre comment travailleurs et employeurs peuvent évaluer les compétences générales, d’autre part. En voici quelques exemples :
- Outil d’évaluation des compétences en matière d’employabilité : de nombreux programmes existent pour aider les personnes à acquérir des compétences sociales et émotionnelles (CSE), mais ils ciblent à une écrasante majorité les enfants et les jeunes. De plus, les méthodes d’évaluation des CSE rencontrent bien souvent des limites dues aux préjugés des observateurs et à l’absence de prise en compte du contexte. Pour combler ces lacunes, Futureworx a élaboré l’outil d’évaluation des compétences en matière d’employabilité (ESAT), un outil en ligne conçu pour évaluer et perfectionner les CSE.
- Compétences Transformation Alimentaire Canada : en s’appuyant sur son cadre d’apprentissage et de reconnaissance validé par l’industrie, Compétences Transformation Alimentaire Canada a élaboré le programme STAC (Skills Training Atlantic Canada) afin de combler les déficits de compétences et de répondre aux besoins de formation du secteur. Ce programme proposait des cours en ligne couvrant les compétences techniques et socio-émotionnelles pour différents groupes de professionnels. Le programme pilote STAC a connu le plus grand succès en ce qui concerne le recrutement et la formation de superviseurs dans l’industrie de la transformation des aliments et des boissons.
- Programme de développement des compétences pour le travail de l’avenir : ce projet mené par Greater Fredericton Community Economic Development Agency Inc. visait à intégrer des compétences centrées sur l’humain, comme l’intelligence émotionnelle, avec des compétences techniques, remédiant ainsi aux insuffisances des parcours éducatifs traditionnels à l’heure de préparer les étudiants aux futurs environnements de travail. Les concepteurs du programme ont stratégiquement choisi de travailler avec 19 partenaires du secteur de l’éducation et du secteur privé. Ces partenariats se sont avérés cruciaux et ont facilité l’intégration du programme dans les cadres pédagogiques existants ainsi que son adaptabilité.
Comment former les travailleurs aux compétences techniques, y compris numériques, dans un marché du travail en mutation rapide?
Les besoins en matière de compétences évoluent de façon fulgurante dans l’ensemble des secteurs, révolutionnant au passage la manière dont les travailleurs se perfectionnent, mais aussi le contenu des formations et les modes de prestation. Bien que l’importance des compétences numériques soit largement reconnue, les employeurs ont encore des difficultés à recruter des travailleurs dotés d’une maîtrise élémentaire (utilisation de la suite Microsoft Office ou de logiciels de visioconférence, par exemple). D’autres compétences numériques et techniques demeurent primordiales, en particulier lorsqu’elles sont associées aux compétences générales que l’IA ne parvient pas encore à reproduire.
- Programme de formation avancée en compétences numériques et professionnelles (ADaPT) Les compétences techniques et numériques demeurent très en demande dans le secteur des technologies de l’information (TI), et les employeurs disent avoir de la difficulté à trouver des candidats possédant les compétences nécessaires.Ce programme a été conçu pour remédier à ce décalage en offrant une formation brève, mais intensive, axée sur les compétences numériques, qui s’adresse spécialement aux diplômés de l’enseignement postsecondaire issus de groupes sous-représentés. Grâce à la consultation approfondie des employeurs, le personnel du programme a pu cerner précisément les compétences numériques dont ces derniers ont besoin. Ce programme incluait également une formation aux compétences générales en matière de communication orale. Toutefois, les participants ont fait état de progrès nettement supérieurs en ce qui concerne les compétences numériques avancées.
- Rogers Cybersecurity Catalyst : la cybersécurité est un secteur en plein essor qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre depuis plusieurs années, et de plus en plus d’employeurs cherchent de nouvelles sources de talents encore peu exploités.. Dans ce contexte, Rogers Cybersecure Catalyst a lancé en 2020 le programme de formation accélérée en cybersécurité (ACTP, Accelerated Cybersecurity Training Program) conçu pour permettre aux femmes, aux nouveaux arrivants et aux travailleurs déplacés de suivre deux programmes de certification en cybersécurité reconnus dans le monde entier et d’obtenir une aide à la recherche d’emploi.
Comment intégrer les compétences vertes dans tous les secteurs?
Les compétences qui seront nécessaires pour s’adapter à une économie décarbonée d’un secteur et d’une région à l’autre, ce qui exigera une connaissance détaillée des collectivités locales et des problématiques qu’elles rencontrent. Il est nécessaire de recueillir davantage d’exemples sur les modalités de transition de la main-d’œuvre du secteur des industries contractuelles ou des industries en cours d’abandon vers les éco-industries en pleine croissance.
- Institut pour l’intelliProspérité, véhicules à zéro émission : ce projet de recherche a étudié l’état de préparation de l’Ontario à la transition vers la fabrication de véhicules à zéro émission (VZE) et de batteries en se penchant sur les questions stratégiques suivantes : La main-d’œuvre actuelle du secteur automobile est-elle prête à occuper les nouveaux emplois? Y aura-t-il suffisamment de travailleurs pour répondre à la demande? Quelles seront les nouvelles compétences recherchées? Et quelles mesures les gouvernements, les éducateurs, les syndicats, les employeurs et les prestataires de services d’emploi devraient-ils prendre pour soutenir la transition de la main-d’œuvre?
- Construire demain : cette étude avait pour but de mieux comprendre les effets du Plan de réduction des émissions (PRE) du Canada et de la transition vers une économie sobre en carbone sur certains secteurs, dont la construction. En particulier, elle a établi des projections relatives aux conséquences du PRE sur la croissance globale à long terme de l’économie canadienne et du marché du travail.
- Des couteaux aux boutons de commande : Il a été démontré que la fabrication intelligente et les techniques d’automatisation favorisent l’adoption de pratiques plus durables. Toutefois, pour les mettre en œuvre, les producteurs de viande ont besoin de connaître les compétences que leur personnel possède à l’heure actuelle et celles qu’il lui faudra acquérir. Cette étude avait pour but de cartographier les compétences requises pour réussir cette transition.
 Ce que nous apprenons
Ce que nous apprenons
Les compétences générales sont de plus en plus recherchées
Les chercheurs de l’Université McGill ont étudié l’évolution des exigences professionnelles entre 2017 et 2022, et ont constaté que l’accent est davantage placé sur les compétences requises, et moins sur le niveau d’éducation. Si ces deux facteurs sont complémentaires, il ressort également des travaux de recherche que les employeurs connaissent de mieux en mieux les compétences, en particulier générales, qu’il faut posséder pour occuper tel ou tel emploi. À titre d’exemple, la part des offres d’emploi exigeant des compétences cognitives a augmenté de 3,4 p. 100 entre 2017 et 2022, avec une hausse respective de 7 p. 100 et de 10,2 p. 100 en ce qui concerne les compétences sociales et les compétences en matière de caractère. Les compétences techniques, dont le rôle reste certes important, ont quant à elles enregistré une baisse ou une faible croissance. Ainsi, les compétences en finance ont diminué de 8 p. 100, tandis que les compétences logicielles et en littératie informatique élémentaire ont respectivement augmenté de 0,6 p. 100 et de 1,5 p. 100 seulement.
Le Conference Board du Canada s’est efforcé de comprendre la demande de compétences générales à l’embauche, et a constaté que les compétences interpersonnelles telles que la communication et le travail d’équipe font partie des plus recherchées par les employeurs, le leadership et l’adaptabilité étant aussi des qualités fréquemment mentionnées dans les offres d’emploi de haut savoir. C’est en Ontario que la demande de compétences générales pour les travailleurs du savoir était la plus importante, tandis que la hausse la plus rapide de la demande au cours des cinq dernières années a été enregistrée dans les provinces de l’Atlantique. Les secteurs qui privilégient davantage les compétences générales sont notamment les services financiers et d’information, suivis par les secteurs de l’éducation et des soins de santé. Les compétences générales font l’objet d’une plus forte demande dans les emplois axés sur le savoir qui exigent une formation postsecondaire, comparativement à ceux qui ne requièrent qu’un diplôme d’études secondaires.
Pour aller plus loin, le Conference Board du Canada a analysé les compétences utiles pour l’avenir dans trois groupes d’industries, à savoir les industries productrices de biens, les industries de services fondés sur le savoir et les industries de services techniques et manuels. D’après les prévisions de cette étude, les besoins en matière de compétences techniques vont diminuer dans chacun des trois groupes, tandis que les compétences générales, telles que la communication et les compétences analytiques, seront de plus en plus recherchées. En outre, les emplois dans ces secteurs ont davantage besoin de travailleurs qui possèdent plusieurs compétences, contrairement aux emplois dont les tâches sont répétitives et ne nécessitent qu’une seule compétence technique.
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a décidé d’élaborer son programme à la lumière des constatations d’un sondage sur l’importance des compétences générales dans le marché du travail d’aujourd’hui. En effet, les réponses ont indiqué, d’une part, que les compétences générales étaient des atouts fondamentaux pour les employeurs, et, d’autre part, qu’il existait un déficit en la matière chez les travailleurs. Pour combler cette lacune, le CCNB a mis au point un programme visant à former efficacement les professeurs en poste à l’enseignement et à l’évaluation des compétences générales (au moyen de l’outil d’évaluation des compétences en matière d’employabilité [ESAT]) telles que le travail d’équipe, les techniques de présentation et l’adaptabilité, en plus des compétences techniques.
Le programme In Motion & Momentum+ (IM&M+) a permis aux personnes qui ont un faible revenu et sont éloignées du marché du travail en raison d’un éventail de facteurs complexes (comme la précarité du logement ou les problèmes de santé) de perfectionner leurs compétences générales. De fait, ces « prérequis à l’employabilité » sont rarement pris en compte dans les services d’emploi traditionnels fournis au Canada. Ce programme avait pour but de favoriser l’acquisition de compétences fondamentales, en montrant aux participants qu’ils possèdent des atouts dont ils peuvent se servir comme source d’espoir, de motivation et de fierté. Comme la situation personnelle de ce groupe de participantes et participants était dynamique et en évolution constante, la participation au programme a été organisée de manière à ce que chacune et chacun dispose des moyens financiers et sociaux nécessaires pour y prendre pleinement part.
Le programme a été évalué au moyen d’un essai contrôlé randomisé, comparant les personnes ayant participé au programme à celles qui n’y ont pas pris part. Les résultats ont démontré que les participants à IM&M+ étaient 42 % plus susceptibles d’être en emploi que les personnes dans une situation similaire ayant eu recours aux services d’emploi traditionnels.
L’Institut du Québec a tâché de comprendre l’impact de l’IA générative sur le marché du travail et de déterminer quelles compétences étaient exposées au risque d’automatisation. D’après ses estimations, l’IA conduira certes à l’automatisation de certains emplois, mais soulagera aussi les travailleurs qui auront la possibilité d’accomplir des tâches davantage axées sur la créativité. L’Institut du Québec a conclu que les initiatives de perfectionnement des compétences au niveau organisationnel et individuel devraient placer l’accent sur la formation à l’utilisation efficace de l’IA générative au travail, comme la communication et la rédaction, ainsi que la pensée créative, en insistant sur les compétences qui ne peuvent pas encore être reproduites par l’IA générative.
Les compétences techniques et numériques sont essentielles, et sont décuplées lorsqu’elles sont associées aux compétences générales
Alors que les industries cherchent de nouveaux moyens d’intégrer la technologie dans leur mode d’exploitation, le besoin en matière de compétences techniques et numériques se fait de plus en plus sentir. Dans l’agriculture, par exemple, les chercheurs de l’Université de la Saskatchewan ont étudié des initiatives axées sur les métadonnées et décrit comment l’utilisation de la technologie peut optimiser la prédiction des tendances météorologiques et du rendement des cultures. Ces progrès exigent des travailleurs agricoles un niveau de compétences techniques et numériques plus élevé que par le passé. La recherche met en évidence une hausse de la demande de personnel capable d’associer compétences générales et numériques.
Les programmes qui intègrent les compétences générales à la formation aux compétences techniques et numériques permettent aux participants d’acquérir un profil plus polyvalent. À titre d’exemple, le Collège Sheridan a conçu un programme pour aider les entrepreneurs ayant droit à l’équité à élaborer des plans de marketing numérique qui associaient compétences techniques, numériques et interpersonnelles. Résultat : les participants aux deux premières cohortes ont augmenté leur chiffre d’affaires annuel de 242 p. 100 et de 121 p. 100, respectivement.
Les initiatives financées par le CCF démontrent qu’il est possible d’évaluer et de valider les compétences générales de manière crédible. Avec le soutien du CCF, le projet Success@Work Skills du Manitoba Institute of Trades and Technology a mis à l’essai un cadre de microcertifications permettant de valider les compétences générales des jeunes Autochtones dans le sud du Manitoba. Les domaines de compétences ont été définis par le biais d’évaluations des besoins auprès des employeurs locaux, de façon à combler les déficits relevés par l’industrie. Ce projet s’opposait à la conviction presque unanime qu’il est difficile pour les employeurs de valider les compétences générales telles que la communication, le travail d’équipe et la résolution de problèmes. Cette crédibilité a pu être obtenue en intégrant les cadres d’acquisition des compétences générales dans des programmes de formation technique déjà approuvés.
D’autres projets financés par le CCF démontrent que l’inclusion consolide les résultats. IDFusion Software et l’University College of the North ont travaillé en partenariat avec les communautés autochtones pour créer des programmes de formation en technologies de l’information (TI) mêlant savoir autochtone et contenu technique. Ces programmes ont permis à des Autochtones de s’implanter dans le secteur des TI tout en contribuant à remédier aux pénuries locales de main-d’œuvre. Les modèles en question ont été élaborés conjointement avec des groupes autochtones, en associant les questions du savoir autochtone au contenu technologique proprement dit et en proposant des modules de formation dirigés par des Autochtones.
Les travaux de recherche laissent également entendre que les modèles traditionnels sous-tendant les programmes d’enseignement postsecondaire doivent être repensés et qu’il faut réfléchir aux moyens d’enseigner les compétences générales parallèlement aux compétences techniques. D’après une étude de l’Université Carleton, la formation en gestion ancrée dans des approches concurrentielles est moins adaptée à l’économie numérique collaborative d’aujourd’hui. Les entreprises comptent désormais sur le travail d’équipe, la coopération et le leadership inclusif pour préserver leur compétitivité. Autant de compétences qu’elles ne peuvent pas se permettre de négliger.
Il est capital de savoir utiliser l’intelligence artificielle
Le recours à l’intelligence artificielle (IA) au Canada connaît un essor rapide, le taux d’adoption par les entreprises ayant pratiquement doublé entre 2021 et 2023, selon une tendance qui s’est poursuivie en 2025. L’avènement d’outils comme ChatGPT a déplacé le débat de la simple automatisation des postes à l’optimisation des facultés humaines avec l’aide de l’IA. Cette évolution soulève plusieurs questions de premier plan :
- Quels sont les types de compétences requis pour réussir dans un environnement de travail intégrant l’IA?
- Comment les employeurs doivent-ils accompagner les employés?
- Quelles politiques faut-il mettre en place pour protéger les travailleurs, en particulier ceux issus de groupes sous-représentés, dont les emplois sont exposés au risque d’automatisation?
Les travaux de recherche étudiant l’incidence de l’IA sur les marchés du travail canadien et québécois se sont intéressés aux types d’emplois les plus susceptibles d’être automatisés avec l’émergence de l’IA générative (p. ex. : ChatGPT) et ont déterminé qu’au Canada, environ 29 p. 100 des emplois incluent des tâches répétitives faciles à automatiser, et donc exposées au remplacement par l’IA. L’idée qu’un poste disparaîtra sous l’effet de l’IA et que l’être humain finira par être massivement remplacé par les machines est probablement l’une des craintes les plus fréquemment abordées dans les discussions au sujet de l’IA. Cela étant dit, l’Institut du Québec a constaté qu’il n’existe actuellement aucune donnée probante attestant qu’un tel scénario puisse se produire aux premiers jours de sa mise en œuvre. Ces deux études mettent en évidence diverses compétences que l’IA a peu de chances de reproduire et soulignent la nécessité que les travailleurs s’adaptent à l’évolution du marché du travail en perfectionnant leurs compétences générales, dont la communication, la pensée critique et la négociation. Le projet de l’Institut du Québec a déterminé par ailleurs que les travailleurs possédant un niveau de maîtrise des compétences générales supérieur parviennent également à utiliser plus efficacement l’IA, car ils lui posent de meilleures questions et sont à même de valider les réponses fournies. Cela prouve l’importance d’acquérir les compétences générales et numériques requises pour utiliser l’IA et l’adapter en milieu de travail.
Deux projets financés par le CCF avaient pour objectif de tester le recours à l’IA dans certains emplois. Dans le cadre du premier projet, l’Institut de valorisation des données (IVADO) a créé des cours de formation adaptés à neuf emplois différents, chacun axé sur les compétences en IA requises pour le poste. Ce projet incluait un outil d’autodiagnostic et un processus de certification à l’issue du programme. Les participants ont pu déterminer dans quelles compétences en IA ils avaient des lacunes. Si l’outil d’autodiagnostic a finalement pu être déployé, suscitant une attention internationale, le processus de certification s’est révélé plus compliqué que prévu à mettre en œuvre, principalement en raison de difficultés à trouver des cadres existants susceptibles d’être adaptés au programme de l’IVADO. En dépit de ces problèmes, une fois mis en œuvre, l’outil d’autodiagnostic a répondu aux besoins des participants et le programme a formé plus de 3 000 personnes.
Dans le cadre du deuxième projet, l’University Health Network a évalué les pratiques en matière d’IA dans le domaine de la santé. Le recours à l’IA pourrait donner lieu à d’importants gains d’efficacité, dont l’amélioration des soins prodigués aux patients et la réduction des coûts. Ce projet a mis à l’essai plusieurs approches visant à réduire les attitudes négatives vis-à-vis de l’intégration de l’IA dans les soins de santé, et ce, en transformant les mentalités, les compétences et les outils des professionnels. Le premier élément (les mentalités) avait pour but de susciter la curiosité des participants. Pour ce faire, le personnel du programme devait commencer par renforcer la confiance en l’IA en exposant des cas réels d’utilisation dans les soins de santé et en laissant les participants exprimer librement leurs éventuelles préoccupations. La phase axée sur les compétences a insisté sur le fait que l’apprentissage doit être étroitement adapté en fonction des emplois. Enfin, la dernière phase a doté les participants des outils d’IA nécessaires pour exploiter l’IA au travail. À cette fin, le personnel du programme s’est assuré que les participants pourraient continuer à bénéficier de l’expertise de leaders en IA par le biais d’un mentorat structuré et de possibilités de réseautage permanentes grâce à la création d’une communauté de pratique.
Il est essentiel d’associer compétences générales, techniques et vertes pour réussir dans les industries émergentes
Le CCF a financé plusieurs projets afin de mieux comprendre les compétences requises pour mener à bien la transition vers une économie sobre en carbone, et notamment pour atténuer ses répercussions négatives en fonction des secteurs et des régions. Selon l’Institut pour l’intelliProspérité, si la transition écologique contribuera in fine à créer davantage d’emplois, divers secteurs comme l’industrie pétrolière et gazière ou encore l’agriculture seront amenés à perdre des emplois à court terme, en particulier dans les régions du pays dépendantes des ressources où les travailleurs seront par conséquent exposés au risque de déplacement. Toutefois, un moyen de soutenir les travailleurs des secteurs en déclin consisterait à les former en vue d’un redéploiement vers des emplois plus verts. Une solution d’autant plus réalisable en assurant une mise en concordance efficace des compétences entre les secteurs.
Le projet d’ECO Canada s’est penché sur une question similaire, en s’intéressant aux compétences requises dans 15 professions en croissance relevant de l’économie bleue. En effet, plusieurs secteurs concernés, allant des énergies renouvelables à l’exploitation piscicole, en passant par le tourisme, se heurtent à un déficit de compétences techniques, souvent accompagné de lacunes en matière de compétences générales et d’un manque de connaissance des pratiques de durabilité environnementale. Certaines professions qui ne nécessitaient pas, jusqu’alors, un profil de compétences varié se complexifient de plus en plus et requièrent désormais la maîtrise d’un ensemble spécialisé de compétences générales, techniques et vertes. À titre d’exemple, pour concevoir une exploitation terrestre de salmoniculture, les ingénieurs doivent non seulement posséder les compétences techniques nécessaires à la création des installations et au maintien de la qualité de l’eau, mais aussi améliorer leurs compétences en gestion afin de diriger leurs équipes et acquérir des compétences vertes leur permettant de garantir que les saumons sont élevés de manière durable.. Ce projet a mis au point des profils de compétences exhaustifs sous-tendant une économie bleue durable et a fait en sorte que les programmes de formation postsecondaire locaux tiennent compte, dans leur conception, des compétences générales (y compris en leadership) et environnementales propices à l’emploi dans ce secteur.
Prenant acte du rôle crucial que les compétences vertes seront amenées à jouer dans le secteur de la construction, le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDC) a élaboré un programme d’envergure visant à former des travailleurs déplacés du commerce de détail ou de l’hôtellerie vers le secteur de la construction, en mettant tout particulièrement l’accent sur les techniques d’écoconstruction. Le CBDC a fait appel à son réseau étendu d’employeurs pour créer des programmes d’études spécialement destinés à accélérer la formation de ces travailleurs. Bien que l’approche se soit finalement avérée efficace pour recruter un grand nombre de travailleurs dans le secteur de la construction, il est apparu que beaucoup de participants manquaient initialement de nombreuses compétences comportementales et de connaissances de base en construction, ce qui les empêchait de prendre pleinement part au processus de perfectionnement.
Dans le cadre d’un autre projet, ECO Canada a démontré plus avant pourquoi il est si important d’assurer une mise en concordance efficace des compétences pour réussir la transition vers la carboneutralité. Ce projet visait à recenser les compétences existantes parmi la main-d’œuvre des industries forestière, pétrolière, gazière et minière qui favoriseraient une requalification accélérée dans des emplois sous-tendant la construction d’infrastructures vertes dans l’ouest du Canada. À cet effet, un rapprochement a été effectué entre les compétences mises en œuvre par les travailleurs à leur poste actuel et celles dont ils auraient besoin pour se reconvertir dans le cadre de projets d’infrastructure verte. Comme l’a démontré ce projet, bon nombre de compétences professionnelles sont transférables entre ces industries. Cette « carte des compétences » s’est avérée utile pour mobiliser les employeurs au titre du volet de formation du programme, dans la mesure où elle leur a permis de visualiser concrètement les domaines dans lesquels les travailleurs pourraient perfectionner leurs compétences et la manière dont cette démarche conduirait à leur intégration dans l’industrie de l’écoconstruction. Au total, 75 p. 100 des participants ont trouvé un emploi à l’issue du programme de formation.
S’il est indispensable d’offrir des programmes de formation aux compétences vertes s’adressant aux travailleurs à mi-carrière, le projet de la Business and Higher Education Roundtable (BHER) visait à comprendre les mesures qui permettraient de promouvoir l’acquisition de compétences vertes avant l’entrée dans la vie active. Plusieurs entretiens ont été menés avec des professeurs d’université et de collège au Canada dans le but de déterminer comment les établissements d’enseignement postsecondaire pourraient renforcer la formation aux compétences vertes au sein des programmes d’études existants. Il est apparu que les établissements d’enseignement postsecondaire sont souvent freinés par un manque d’agilité, et de nombreuses parties prenantes interrogées ont décrit le processus de mise à jour des cours ou des programmes pour y inclure un contenu sur le changement climatique et le développement durable comme étant long et bureaucratique. Cela étant dit, malgré la résistance au changement observée au niveau organisationnel, les personnes interrogées estimaient que les compétences vertes sortaient de leur champ d’expertise et ont appelé à renforcer le perfectionnement professionnel pour soutenir le corps professoral dans sa transition personnelle et professionnelle vers la carboneutralité et l’enseignement des compétences vertes. Parmi les solutions proposées, citons la multiplication des occasions d’apprentissage intégré au travail dans les programmes d’études et la création de centres de formation aux compétences vertes à l’intention des étudiants comme des enseignants.
 Pourquoi c’est important
Pourquoi c’est important
Entre déficits de compétences et pénuries de main-d’œuvre, le Canada est en proie à l’incertitude et doit composer avec la hausse du chômage dans des régions et secteurs clés. Face à cette situation, le gouvernement du Canada a annoncé la prise de plusieurs mesures, dont l’amélioration du libre-échange et de la mobilité de la main-d’œuvre à l’échelle du pays, la réalisation d’un investissement historique dans les Forces armées canadiennes et la création de nouveaux bureaux en vue d’accélérer divers projets d’importance nationale ainsi que la construction de logements abordables à grande échelle.
Ces initiatives sont tributaires de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente. Or, d’importants points d’interrogation demeurent à l’heure de savoir si nous disposerons des personnes et des compétences requises, au bon endroit et au bon moment. Le gouvernement fédéral a récemment injecté plusieurs milliards de dollars dans l’écosystème canadien du perfectionnement des compétences et de la formation, y compris des fonds supplémentaires au titre des ententes sur le développement du marché du travail afin de soutenir la formation et la requalification de quelque 50 000 travailleurs. Citons en outre la création d’une plateforme nationale de formation en ligne pour aider les adultes à trouver des formations brèves en fonction du type de compétence, du lieu géographique et du format, la constitution d’alliances pour la main-d’œuvre et la mise en place d’un fonds d’innovation pour soutenir les secteurs à risque comme les pièces automobiles, la sidérurgie et l’industrie de l’aluminium, ainsi que les secteurs à fort potentiel de croissance tels que l’énergie, l’exploitation des minerais critiques et la fabrication avancée.
Bien que impressionnants, ces investissements ne suffisent pas à relever les défis à venir. Pour bâtir une main-d’œuvre résiliente capable de répondre et de s’adapter aux mutations du marché du travail, qu’elles surviennent sous l’effet de perturbations imprévisibles ou dans le cadre de transitions à plus long terme, nous devons mettre en place un éventail de parcours de formation et de perfectionnement professionnel qui doteront la population des compétences dont elle a besoin pour s’intégrer et progresser dans des marchés du travail dynamiques, opérer des transitions et se reconvertir. Les priorités sont notamment les suivantes :
- Intelligence artificielle. Quel que soit leur secteur d’activité, les employeurs devraient d’ores et déjà accroître les investissements visant à former leur personnel aux compétences en IA et réfléchir à la manière d’intégrer l’IA dans leur mode d’exploitation pour préserver leur compétitivité. L’écosystème des compétences et de la formation compte un certain nombre d’acteurs réputés dispensant un enseignement d’excellente qualité adapté à un éventail croissant de cas d’usage propres à différents secteurs. Les travailleurs peuvent demander conseil auprès des employeurs, des syndicats, des représentants sectoriels et des associations professionnelles. Pour étendre encore l’utilisation de l’IA, l’Initiative régionale en matière d’intelligence artificielle est actuellement mise en œuvre par sept agences de développement économique régional et dispose d’un budget de 200 millions de dollars sur cinq ans. Ce programme aide les PME exerçant dans des secteurs stratégiques à opérer la transition vers l’IA grâce à l’acquisition de matériel, de technologies et de compétences. Cette initiative comporte deux volets, dont seulement un vise à combler les lacunes en matière de compétences en IA au sein des PME. Il est nécessaire de mettre en place d’autres programmes axés sur le perfectionnement des compétences pour répondre aux besoins des PME et des travailleurs dans les secteurs essentiels.
- Compétences générales. L’IA offre aux travailleurs un moyen de se consacrer à des tâches différentes, de nature plus complexe. Les compétences en pensée critique et en rédaction sont essentielles pour remplir des fonctions qui exigent un éventail de compétences de plus en plus diversifié, dans lequel la communication efficace et la négociation joueront un rôle plus important que par le passé. Si d’autres types de compétences (techniques, numériques, vertes) demeurent très utiles et méritent également notre attention, les compétences générales doivent faire partie intégrante de la formation professionnelle dans ces domaines, dans la mesure où elles sont essentielles pour cultiver la résilience dont les travailleurs ont besoin. Pour soutenir encore davantage le perfectionnement des compétences générales, il convient de généraliser la mise en œuvre d’évaluations en la matière, en particulier parmi les employeurs, de façon qu’ils puissent mieux évaluer les compétences des candidats et de leur personnel.
Pour mettre en place un éventail de parcours de formation et de perfectionnement professionnel, il faut pouvoir tenir compte des différences observées entre les travailleurs, les régions, les secteurs et les stades de carrière, et proposer ainsi des options au niveau individuel, organisationnel et systémique. L’un des moyens d’assurer une telle personnalisation consiste à adopter une approche territorialisée, qui s’adapte aux besoins particuliers des collectivités et des groupes à l’échelon local (travailleurs d’âge mûr, jeunes diplômés, nouveaux arrivants titulaires d’un diplôme d’études supérieures mais sans expérience canadienne, etc.). Comme l’ont démontré le Conference Board du Canada et l’Institut pour l’intelliProspérité, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les besoins en matière de compétences varient localement pour planifier des initiatives de formation et de perfectionnement professionnel territorialisées. Les approches territorialisées s’appliquent aux collectivités en transition vers une économie à plus faible intensité carbonique, ainsi qu’aux actions entreprises pour aider les régions et les secteurs à faire face aux répercussions du conflit commercial qui oppose actuellement le Canada aux États-Unis. Les décideurs politiques devraient envisager de réunir des experts dans ces domaines en vue de favoriser la conclusion de partenariats permettant de tirer parti de l’information locale et régionale sur le marché du travail, de façon à concevoir des solutions adaptées aux besoins locaux. Toutefois, bon nombre de programmes fédéraux sont mis en place uniquement après un licenciement ou une période de chômage prolongée. S’il convient de maintenir ces initiatives, il faut également élaborer des programmes de perfectionnement professionnel à visée proactive qui favorisent la requalification des travailleurs vulnérables en raison du contexte régional ou sectoriel.
Pour relever les défis à venir et concrétiser nos ambitions nationales, les acteurs de l’écosystème des compétences et de la formation manifestent une volonté croissante de mettre au jour des stratégies créatives et pratiques capables de renforcer la résilience de la main-d’œuvre canadienne à court terme comme à long terme. Dans cette optique, le CCF a formé le Groupe de travail sur la main-d’œuvre résiliente qui réunit des experts en matière de politiques publiques et d’acquisition de compétences, ainsi que des représentants des employeurs et des travailleurs issus de différents secteurs et régions, afin de formuler de manière collaborative des recommandations stratégiques fondées sur des données probantes au chapitre des compétences et de l’emploi.
 Prochaines étapes
Prochaines étapes
Le Centre des Compétences futures ontinue d’investir dans des projets de recherche et d’innovation sur les compétences et la formation qui produisent des données probantes sur les enjeux cruciaux liés aux compétences et à l’avenir du travail. Il est impératif de bien comprendre ce qui fonctionne, pour qui et dans quel contexte, et — tout aussi important — ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Les enseignements tirés des évaluations nous orientent dans la bonne direction, en identifiant ce qui est prometteur et mérite d’être étendu ou reproduit, tout en élargissant la gamme de parcours de formation et de perfectionnement disponibles. De nouvelles initiatives peuvent faire fond sur ce socle de données probantes afin d’écourter les délais de mise en œuvre et d’accélérer la montée en puissance.
Le Centre des Compétences futures continuera de réunir les partenaires et les parties prenantes de l’écosystème des compétences et de la formation pour faire émerger des idées et des approches prometteuses en vue de préparer la population canadienne à l’avenir du travail.
 Projets inclus
Projets inclus
La pandémie et les pénuries actuelles de main-d’œuvre ont-elles modifié la qualité des emplois ?
Programme de développement des compétences pour le travail de l’avenir
Maîtrise des compétences numériques par les travailleurs
Programme de formation avancée en compétences numériques et professionnelles (ADaPT)
Success@Work Skills—Préparer la main-d’œuvre et les systèmes à naviguer dans le changement
Préparer l’avenir de la main-d’œuvre du secteur de la transformation des aliments et des boissons
FUSION: Future Skills Innovation Network for Universities, Concordia University
Micro, mais costaud : les microcertifications sectorielles stimulent l’hôtellerie et la restauration
l’Intelligence artificielle et les impacts sur la main d’oeuvre québécoise, Institut du Québec
Des questions sur notre travail ? Souhaitez-vous avoir accès à un rapport en anglais ou en français ? Veuillez contacter communications@fsc-ccf.ca.
Comment Citer Ce Rapport
Richter, S., McDonough, L. (2025) État des compétences : Pour une main-d’œuvre canadienne résiliente : Les compétences à acquérir dès maintenant et pour l’avenir. Toronto: Centre des Compétences futures. https://fsc-ccf.ca/fr/projets/sos-resilient-by-design/
Plus de CCF
In Motion & Momentum+ (IM&M+)
Le recyclage des travailleuses et travailleurs du commerce de détail déplacés
La transition des étudiants étrangers vers l’emploi
Ce rapport a été produit sur la base de projets financés par le Centre des compétences futures (CCF), avec le soutien financier du gouvernement du Canada. Les opinions et interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.