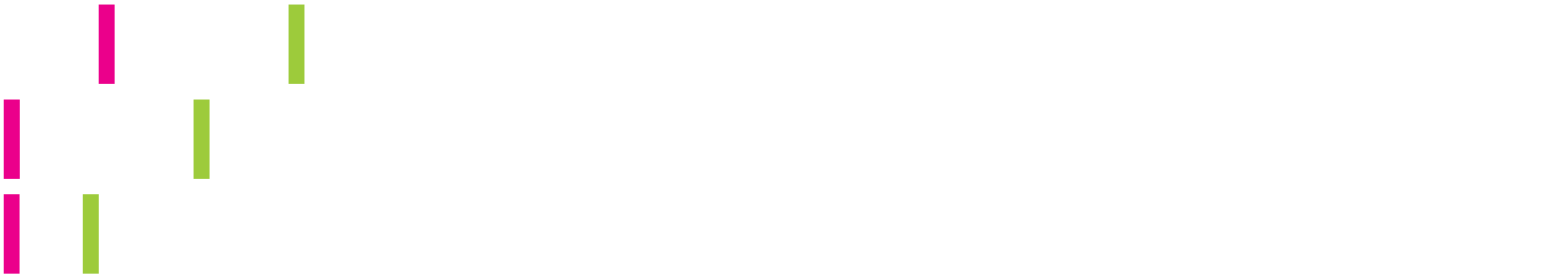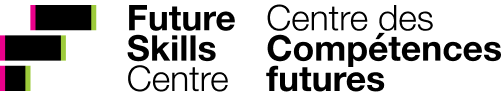RAPPORT DE PERSPECTIVES DE PROJET
« Elles font une différence » revisité : les femmes en génie
Elles font une difference revisitees
 Sommaire
Sommaire
En 1992, le Comité canadien des femmes en ingénierie a publié le rapport Elles font une différence, qui identifiait les obstacles importants à l’entrée et à la réussite des femmes dans les professions de génie et détaillait les cibles et les recommandations de changement. Plus récemment, Ingénieurs Canada a lancé son initiative 30 en 30, dans le but d’augmenter le pourcentage d’ingénieurs nouvellement titulaires qui s’identifient comme des femmes à 30 % d’ici 2030. Malgré ces efforts, les progrès ont été limités. En 2022, les femmes représentaient seulement 25 % des étudiants de premier cycle en génie, 15 % des professionnels du génie et 20 % des ingénieurs nouvellement agréés.
Dans le milieu de l’ingénierie, les femmes continuent d’être confrontées à un « climat glacial » qui comprend des préjugés sexistes dans les évaluations de performance et la rémunération, des attitudes misogynes et sexistes et des microagressions.
Le manque de diversité dans l’ingénierie a des effets d’entrainement sur la conception des produits, souvent avec des conséquences fatales. Par exemple, les données sur les accidents entre 1998 et 2008 aux États-Unis révèlent que les conductrices portant la ceinture de sécurité sont 47 % plus susceptibles d’être gravement blessées que les conducteurs masculins, car la conception des mannequins féminins utilisés pour les essais de collision n’a pas pris en compte les différences biologiques entre les corps des hommes et des femmes.
De plus, des équipes diversifiées produisent de meilleures performances. Elles sont nettement plus susceptibles d’apporter une innovation radicale et d’améliorer les performances financières, et d’éviter la pensée de groupe. Il y a de solides impératifs moraux et commerciaux pour promouvoir la participation des femmes en génie.
Ce rapport examine les progrès réalisés par les femmes en génie et les lacunes qui subsistent, et s’appuie sur des recherches et des pratiques exemplaires pour faire progresser un plan d’action fondé sur des données probantes.
Perspectives clés
En 2022, 25 % des étudiants de premier cycle en génie étaient des femmes, contre 14 % en 1992, soit une différence de seulement 11 points de pourcentage en 30 ans.
Les problèmes d’aujourd’hui sont assez semblables à ceux de 1992 — manque de modèles, socialisation des filles, pédagogie et programmes d’études centrés sur les hommes, obstacles à l’emploi et à l’avancement — et le climat glacial persiste.
Il existe des différences statistiques entre les disciplines : les femmes représentent plus de la moitié de l’ensemble des ingénieurs en biosystèmes (54,5 %), mais seulement 19,5 % des ingénieurs en électricité. Il existe également des différences statistiques entre les établissements en ce qui a trait aux inscriptions des Canadiennes au premier cycle, passant de 39 % à l’University of Toronto à 9,7 % au Conestoga College.
 L’enjeu
L’enjeu
La conception technique fait partie intégrante de nos vies, affectant tout, des automobiles que nous conduisons aux dispositifs médicaux et aux logiciels et algorithmes qui alimentent la prise de décision, et il est prouvé que la diversité dans la profession a un impact sur le design.
L’ingénierie est également une voie d’accès à un emploi bien rémunéré, et la ségrégation professionnelle (p. ex., la sous-représentation des femmes dans les STIM) a été un facteur associé à l’écart salarial. Des efforts sont en cours depuis plus de 30 ans pour faire progresser les femmes en génie, mais de nombreux obstacles persistent. Il faut un changement systémique pour éliminer les obstacles aux niveaux sociétal, organisationnel et individuel.

 Ce que nous examinons
Ce que nous examinons
Cette recherche exploratoire évalue les disparités persistantes entre les genres dans la profession d’ingénieur au Canada et explore des stratégies pour surmonter les obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées. Elle passe en revue les progrès réalisés depuis la publication du rapport Elles font une différence du Comité canadien des femmes en ingénierie en 1992, lequel soulignait pour la première fois les défis auxquels les femmes font face dans ce domaine.
Ce rapport passe en revue les données recueillies en 1992 sur l’inclusion des femmes dans l’enseignement du génie, le leadership et la profession, et les compare à celles d’aujourd’hui. Il fournit également une analyse approfondie des obstacles auxquels les femmes en génie sont confrontées, encore une fois en comparant l’analyse de 1992 à celle d’aujourd’hui.
Enfin, le rapport examine les stratégies utilisées pour éliminer les obstacles, en mettant l’accent sur les initiatives qui favorisent l’équité, la diversité et l’inclusion ainsi que l’avancement professionnel. Il se termine par des recommandations visant à créer des environnements plus inclusifs. Les recommandations insistent sur la nécessité d’efforts coordonnés de la part des organismes de réglementation, des établissements d’enseignement, des employeurs et des associations professionnelles pour que les femmes adoptent la profession et soient soutenues dans leur évolution professionnelle et le développement de leur leadership.
 Ce que nous apprenons
Ce que nous apprenons
Le rapport documente les changements intervenus en ce qui concerne les femmes en génie depuis la rédaction en 1992 du rapport Elles font une différence. Bien que certains progrès aient été réalisés, ils ont été plus lents que beaucoup l’espéraient.
Cette étude nous aide à comprendre la complexité de faire bouger les choses en ce qui concerne la représentation des femmes en génie et les facteurs à plusieurs niveaux qui peuvent stimuler ou entraver le changement. Le rapport explore également 30 ans de recherche sur les obstacles rencontrés par les femmes en génie et les stratégies visant à promouvoir leur participation. En incluant des données désagrégées qui explorent différentes disciplines d’ingénierie, écoles et régions, nous jetons les bases d’une étude plus approfondie sur ce qui fonctionne. Par exemple, certains programmes universitaires ont considérablement augmenté la représentation des femmes en mettant l’accent sur le leadership, en fixant des objectifs, en réexaminant les programmes d’études et la pédagogie, en ciblant la sensibilisation, en offrant un soutien global et plus encore. Certaines disciplines d’ingénierie ont atteint la parité hommes-femmes ; il faudra d’autres recherches pour comprendre comment et pourquoi, car les explications conventionnelles (par exemple, « les femmes ont peur des mathématiques ») ne sont clairement pas pertinentes.
De même, certaines entreprises d’ingénierie ont redoublé d’efforts pour attirer et retenir les femmes, et les résultats sont mesurables, tandis que d’autres n’ont pas changé leurs pratiques ni constaté de changements dans la participation des femmes depuis des décennies. Il est crucial de bien comprendre les mécanismes qui fonctionnent pour une certaine population et de les adapter pour définir une stratégie, fixer des cibles et désigner des responsabilités. Les interventions doivent se faire aux niveaux sociétal, organisationnel et individuel.
Au niveau sociétal — Il est essentiel de s’attaquer aux stéréotypes, au manque de modèles et à la socialisation des filles pour faire évoluer les attitudes à l’égard de la nature genrée de l’ingénierie. Il est essentiel d’avoir des objectifs clairs et un plan de mise en œuvre global, transparent et responsable. Les politiques gouvernementales et le soutien des organismes de règlementation sont aussi essentiels. Par exemple, les politiques d’approvisionnement du gouvernement ont eu un impact sur les projets de génie civil et d’infrastructure, où les gros contrats peuvent influencer l’embauche et la sous-traitance. Le financement gouvernemental de la recherche et de l’enseignement en génie peut également jouer un rôle en exigeant la production de rapports sur les données et les stratégies désagrégées.
Les organismes d’accréditation peuvent mettre davantage l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans leurs normes. Les organismes de règlementation provinciaux, comme Engineers and Geoscientists British Columbia, l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta et Professional Engineers Ontario, jouent un rôle important grâce à leurs lignes directrices de pratique professionnelle qui traitent de l’équité, de la diversité et de l’inclusion en ce qui concerne les responsabilités et les exigences déontologiques des ingénieurs.
Au niveau organisationnel — Les actions des employeurs et des établissements d’enseignement comptent. Nous devons redoubler d’efforts dans l’enseignement des mathématiques et des sciences aux filles de la maternelle à la 12e année et nous attaquer aux modèles de rôle et aux options de carrière, afin que les filles ne s’excluent pas d’elles-mêmes des cours à la base de l’ingénierie. Les établissements d’enseignement postsecondaire doivent se fixer des objectifs précis et se pencher sur les processus d’admission et la pédagogie. Les programmes et les curriculums qui vont au-delà d’une approche purement technique et qui mettent l’accent sur les valeurs centrées sur l’humain (p. ex., comment les solutions technologiques peuvent-elles améliorer la qualité de vie) sont plus susceptibles d’attirer et de retenir les femmes. Au sein de l’ingénierie, certaines disciplines (comme l’ingénierie des biosystèmes) sont plus équilibrées entre les genres.
Les employeurs doivent s’attaquer aux obstacles à l’embauche et au maintien en poste des femmes ingénieures et créer des milieux de travail plus inclusifs. Par exemple, certaines entreprises ont des cibles et exigent des listes équilibrées de candidates et candidats lors des présélections. D’autres privilégient l’embauche de femmes et de personnes de groupes méritant l’équité dans les programmes coopératifs. D’autres sont signataires d’initiatives volontaires de l’industrie, comme 30 en 30 et le Défi 50 – 30.
Au niveau individuel — Il faut avoir une approche globale qui tient compte des aspirations et des cheminements de carrière des femmes ingénieures, ainsi que des préjugés dans le monde de l’éducation, des responsables politiques et d’autres parties prenantes. Les programmes de formation devraient viser à sensibiliser les femmes aux obstacles structurels qui les empêchent d’entrer et de progresser dans le domaine, y compris la manière dont les préjugés des individus peuvent façonner les opportunités, les pratiques d’embauche, les voies de promotion et les politiques organisationnelles.
 Pourquoi c’est important
Pourquoi c’est important
La sous-représentation des femmes en génie a une incidence sur la conception, l’utilité et la sécurité des produits et services. Cela a également un impact sur les écarts salariaux et les voies d’accès au leadership. Bien que des progrès aient été réalisés au cours des 30 dernières années, de nombreux obstacles systémiques subsistent, ce qui limite la participation et l’avancement des femmes en génie.

État des compétences :
L’IA au service de l’écosystème du développement des compétences
Les outils d’IA appuyés par le CCF ont amélioré les résultats en matière d’adéquation des compétences, d’orientation du développement de carrière et de recrutement. L’efficacité générale de ces outils a été renforcée par la reconnaissance et l’atténuation des préjugés et de la discrimination inhérents à ces technologies.
 Prochaines étapes
Prochaines étapes
D’autres travaux sont en cours pour déterminer des stratégies de compétences et de formation afin de créer des parcours plus inclusifs pour les femmes dans l’enseignement du génie, les milieux de travail, le leadership et l’entrepreneuriat.
Plus de CCF
Typologie des travailleurs à la demande au Canada : Vers un nouveau modèle de compréhension du travail à la demande par l’entremise du capital humain, social et économique
Labo sur l'éducation à la petite enfance
Innovation pour une meilleure intégration
Des questions sur notre travail ? Souhaitez-vous avoir accès à un rapport en anglais ou en français ? Veuillez contacter communications@fsc-ccf.ca.
Comment Citer Ce Rapport
Diversity Institute. (2024). Rapport de perspectives de projet : « Elles font une différence » revisité : les femmes en génie. Toronto : Centre des Compétences futures. https://fsc-ccf.ca/fr/recherche/women-in-engineering/
« Elles font une différence » revisité : les femmes en génie est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compétences futures. Les opinions et les interprétations contenues dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas forcément celles du gouvernement du Canada.